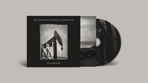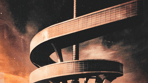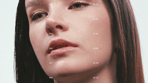IVAN JULIAN : LE PUNK QUI AVAIT VU LE FUTUR...
Guitariste légendaire de la scène punk new yorkaise au mitan des années 70 au sein de Richard Hell and the Voidoids, puis des Clash période Sandinista !, Ivan vient de sortir l’album, Swing You Lanterns, publié sur un label breton. Et l’homme a passé quelques jours en France, à Lanmeur en Bretagne dans le Finistère pour prolonger une collaboration

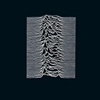

Ivan, si je vous dis… France. Qu’est-ce qui vous vient en tête ?Ivan Julian : Le mot beauté. J’ai souvent joué en France, en Grande Bretagne et dans le reste de l’Europe, mais à chaque fois que je viens ici et que je regarde la nature autour de vos autoroutes, je demande autour de moi à mes amis Français : « Qu’est-ce que vous faîtes à vos arbres pour qu’ils soient aussi beaux ? Vous leur faîte des manucures ? » Il y a ça, et je pense aussi à mon premier séjour en France. C’était avec Richard (Hell)…
Vous n’étiez pas venu jouer avec The Foundations (groupe de soul dont il a été le guitariste de tournée à ses débuts) ?Ivan Julian : Non, on tournait surtout en Yougoslavie, et on jouait principalement dans des palaces. C’était au début des années 70. C’était amusant… Il y avait Phil Lynott (une figure du rock, bassiste et chanteur du groupe de hard rock irlandais Thin Lizzy). J’ai un souvenir de lui. Il était au bar, entouré de jolies femmes, et il était habillé comme Prince le ferait bien plus tard, avec un pantalon et une veste en velours. Voilà, je suis en France aujourd’hui pour parler avec qui le souhaite de mon nouvel album, Swing My Lanterns, publié sur un label rennais (LADTK), discuter avec mon manager, Frank Darcel… Et trouver une baguette (il prononce quelque chose qui sonne comme « baged ») de pain décente à manger.
Attention, quand vous serez en Bretagne, un bagad, c’est comme un groupe, une formation musicale…Ivan Julian : OK. Mais alors comment dit-on « french baguette » en breton ?
On dit baguette.Ivan Julian : OK. Baguette, pas « baged. » C’est noté, enregistré. On m’a dit que si j’allais en Bretagne, il fallait que je mange une crêpe et que je boive du cidre.
Exactement. Avant Marquis, vous aviez déjà collaboré avec son groupe Republik (sur l’album Elements), comment aviez-vous travaillé avec Frank Darcel ?Ivan Julian : J’ai un studio à New York. J’y ai enregistré mes parties de guitares, et les ai envoyées à Frank.
A propos de Frank Darcel, vous souvenez-vous de votre première véritable rencontre ?Ivan Julian : Je crois… Je crois que c’était il y a plus de dix ans. Il était venu à New York pour travailler avec James Chance (chanteur et saxophoniste de James Chance and the contorsions pour qui, Frank a produit l’album Incorrigible ! sorti en 2011).
Je reprends le fil de mes questions. Si je vous dis… Première guitare. Quel souvenir vous revient ?Ivan Julian : C’était une Gibson SG standard. Achetée pour moi par mon père. Ce qui était assez étonnant parce que mon père aimait le jazz et détestait m’entendre jouer du rock’n’roll. Il était dans la Navy, et il aurait voulu que j’y travaille, que je devienne un pilote d’avion de chasse. Mais c’était une très mauvaise idée. Imaginez… Moi, dans le ciel, avec un avion pour lancer des missiles. Non, cela ne l’aurait jamais fait. J’ai donc eu cette guitare, parce que c’était celle de Robin Trower (guitariste du groupe de rock progressif, Procol Harum). Mais en fait, je rêvais d’une autre Gibson, celle qu’on appelait la spéciale. Elle était noire, pas très jolie, mais elle sonnait mieux. Avant j’avais joué du saxophone, et suivi une formation de musicien classique. Quand j’ai reçu cette guitare, je devais avoir 15/16 ans
Si vous aviez commencé par la musique classique, vous souvenez-vous de la première fois qu’un morceau de rock vous a ému et fait changer de trajectoire ?Ivan Julian : Comme je disais, mon père était militaire, et j’ai grandi sur la base américaine de Guantanamo à Cuba. Les médias étaient très contrôlés. Il n’y avait pas de rock’n’roll. Puis, on est revenu aux États-Unis, je pense en 1965, et là, j’ai entendu toute cette musique à la radio. C’était : « Waouh ! Qu’est-ce qui se passe ? Qu’est-ce qui m’arrive ? » Il y avait Bob Dylan, The Temptations, James Brown, tous ces trucs… Et la musique était moins compartimenté. On entendait tout ça à la radio. Ce qui était génial. Je me souviens avoir mis la main sur un petit mange-disques portable et j’avais ce 45 Tours de Little Richard avec un morceau nommé Kansas City sur une face, et un autre baptisé Hey-Hey-Hey-Hey ! sur l’autre face. En l’écoutant, je suis devenu fou. Cette chanson date des années 50 mais aujourd’hui encore elle me fascine.
Si je vous dis… Première idole. Qui vouliez-vous imiter ? A qui vouliez-vous ressembler ?Ivan Julian : Il y a deux réponses à vos questions. Le premier qui m’a subjugué serait Jimi Hendrix. C’est le premier que j’ai vu en concert. Mon frère aîné m’avait emmené le voir. Je devais avoir 12 ans. Son 2èmealbum (Axis : Bold as love) venait de sortir. Sur scène, il était habillé avec toutes ses couleurs différentes. Il avait sa guitare. Il était impressionnant. Je ne voulais pas l’imiter mais il a, comme on dit, poussé des portes pour moi plus tard.
Le fait qu’il était noir était important pour vous ?Ivan Julian : Non, mais je dis cela en pensant que, peut-être, inconsciemment, c’était important.
Je vous demande cela parce que Vernon Reid (guitariste et fondateur du groupe Living Colour) dans le film qui vous est consacré (You don’t know Ivan Julian, sur Vimeo) dit que le fait que vous soyez guitariste et noir lui a montré que c’était aussi possible, envisageable pour lui…Ivan Julian : Vous savez, j’ai vécu ou connu beaucoup de situations de crises extrêmes, comme la crise des missiles à Cuba où tout le monde pensait que c’était la fin du monde, et je ne fais pas attention aux couleurs de peau. Je n’enregistre pas cette information. Mais je ne suis pas non plus naïf, je ne vis pas dans une bulle, spécialement quand on parle de l’Amérique. Je sais que Vernon aime dire cela, mais quand je suis dans un endroit ou sur scène, je ne suis pas en train de me dire : « Je suis le seul noir ici, et le premier à jouer de la guitare. » Je joue, je fais de la musique. C’est tout.
Ca me fait penser qu’un jour, Johnny Hallyday m’a raconté comment il avait découvert Jimi Hendrix dans un club à Londres, et qu’il n’avait pas beaucoup de succès à l’époque. Il était même inconnu. Johnny l’a invité à se produire en première partie de ses concerts en France avec son groupe, The Experience (en octobre 1966)… Jimi et Johnny ont sympathisé. Jimi dormait chez Johnny à Paris, et c’est comme ça que Johnny a eu l’idée d’enregistrer une version française du standard Hey Joe (novembre 1966), qui a fait connaître Jimi Hendrix à travers le monde. Mais je digresse…Ivan Julian : Non, non, c’est important pour moi. Il y a tellement de gens qui me racontent des histoires sur Jimi. Je sais que lorsque Jimi est venu en Europe, il a fait des concerts un peu partout, en Suède, en France, pour se faire connaître.
Un autre musicien noir de New York a eu un peu le même parcours : Lenny Kravitz, inconnu alors aux États-Unis, a été révélé grâce à un passage aux Transmusicales de Rennes en 1989 où il avait subjugué le public et la presse, notamment les journalistes britanniques présents.Ivan Julian : C’est étonnant. Je ne connaissais pas non plus cette histoire.
Mais revenons à mes questions sur ceux qui vous servi de modèle. Vous disiez qu’il y avait deux réponses : Jimi Hendrix et…Ivan Julian : Quand j’ai dû décider quel genre de guitariste je voulais devenir, qui serait mon modèle, il y avait beaucoup de très bons guitaristes dans les années 60, et beaucoup savaient jouer vite et faire des solos, mais Keith… Oui, Keith Richards a été celui qui m’a ouvert les portes. Il ne faisait pas que de la musique, il jouait des chansons et il s’inscrivait dans une histoire, il jouait les passeurs. Hendrix faisait ça aussi. Si vous l’écoutez, vous entendez John Lee Hooker. Avec Keith, il y a aussi cette idée qu’il a renvoyé à l’Amérique sa propre culture, celle qu’elle refusait de reconnaître. Il la lui a ré-enseignée. Dans tout ce qu’il joue, il y a le son de ces vieux mecs venus du blues. En plus, il joue aussi en rythmique. Dans la culture rock, il y a cette idée qu’un bon guitariste doit d’abord et avant tout savoir faire des solos. Je n’ai jamais cru en ça. Et les Voidoids non plus.
Sur le chemin, en venant vous interviewer, je réécoutais Blank Generation où on entend justement un solo de vous, et j’ai réalisé que c’était ce son que l’on entend plus tard chez une groupe anglais post-punk comme Gang of Four…Ivan Julian : Exactement.
Je me souviens, adolescent, avoir emprunté un disque de Richard Hell and The Voidoids, d’écouter Blank Generation et de me dire : « Mais on dirait que cette chanson est comme une maladie. »Ivan Julian : Exactement, Blank Generation est une maladie. Mais je comprends votre sentiment à l’époque. C’était pareil pour moi quand j’écoutais Bob Dylan alors que j’étais un gamin. Ses chansons me mettaient mal à l’aise mais je savais qu’un jour je comprendrais ou plutôt je ressentirais ce qu’elles voulaient dire. Et il y avait cet harmonica ! Aujourd’hui, c’est l’un de mes artistes favoris.
Ce qui est amusant, c’est que dans la mythologie punk, les artistes ne devaient pas savoir jouer de leurs instruments. Et vous, vous avez eu une éducation musicale très poussée et vous êtes considérée comme une légende de la musique punk. Paradoxal, non ?Ivan Julian : Je dois ça aussi aux Fondations. Quand j’ai commencé à tourner avec eux, j’ai eu deux jours pour mémoriser dix morceaux. C’est comme ça que j’ai appris à jouer, à faire de la musique. Si bien que, quand j’ai rencontré Richard (Hell), j’étais bon pour le service. Il y a tellement de mythes qui circulent sur le punk. J’ai deux trucs à dire sur ça. D’abord, au CBGB (le club new yorkais devenu mythique, épicentre du mouvement punk dans les années 70), il y avait toutes les sortes de musiques jouées sur scène, y compris de la country music. Il n’y avait pas que les Ramones, ou nous, ou Patti Smith… Il y avait vraiment tout. Ensuite, notre modèle pour The Voidoids, Robert Quine (guitariste aussi) et moi, la formation qui nous inspirait, c’était les Yardbirds. Un groupe avec deux guitaristes, sans leader. Et, souvent, quand je montre comment jouer le morceau Blank Generation, les gens s’étonnent : « Mais en fait, c’est compliqué à jouer ! » Et oui, c’est compliqué.
Propos recueillis par Frédérick RAPILLY
(Fin de la partie 1 de l’interview)
Yvan Julian « Swing Your Lanterns » (LADTK)
Marquis, en concert le 8 avril à La Rochelle, le 27 avril à Rennes, etc. Toutes les dates sur la page Facebookdu groupe.